Un entretien avec Sophie Rohonyi

Quelle est votre vision de la science politique ?
La science politique est, à mes yeux, un pilier essentiel de nos démocraties. Elle permet de décoder les mécanismes du pouvoir, de comprendre les institutions, les comportements électoraux, les dynamiques partisanes, et d’éclairer les politiques publiques par une analyse rigoureuse. En tant que présidente de DéFI, je vois la science politique non pas comme une discipline éloignée de la réalité, mais comme un outil de réflexion critique indispensable à la conduite de l’action publique. Elle nous aide à penser la complexité, à anticiper les conséquences de nos choix politiques, et à ne jamais cesser d’interroger le sens et l’efficacité de nos décisions.
Mais ma vision de la science politique ne s’arrête pas à sa fonction analytique. Elle a aussi une fonction éthique : celle de poser des questions fondamentales sur la justice, la légitimité, la participation citoyenne, ou encore les contre-pouvoirs. Dans un monde de plus en plus polarisé, soumis à des logiques de court terme et à la pression médiatique constante, la science politique nous invite à prendre du recul, à nous recentrer sur les fondements démocratiques et à ne pas céder à la démagogie.
Elle est donc un pont entre la théorie et la pratique, entre la connaissance et l’engagement. Je souhaite d’ailleurs que ce pont soit mieux emprunté, dans les deux sens : que les responsables politiques s’inspirent davantage des travaux des chercheurs, et que les chercheurs puissent, en retour, mieux comprendre les contraintes du politique. C’est dans ce dialogue permanent que réside, selon moi, la véritable richesse de la science politique.
Dans quelle mesure votre formation universitaire influence-t-elle l'exercice de vos fonctions actuelles ?
Ma formation de juriste a profondément façonné mon rapport à la politique. Elle m’a appris la rigueur intellectuelle, l’importance du doute méthodique, la recherche d’arguments fondés, mais aussi la capacité à comprendre des réalités complexes et parfois contradictoires. Dans l’exercice de mes fonctions actuelles, cela se traduit par une volonté constante d’analyser avant d’agir, d’écouter les différentes voix, de confronter les idées avant de trancher.
Dans un parti comme DéFI, qui défend la nuance, l’indépendance d’esprit et le dépassement des clivages traditionnels, revenir à des principes essentiels du droit comme la séparation des pouvoirs ou la hiérarchie des normes est essentiel.
Ma méthode de travail est basée sur l’analyse des faits, le respect des données empiriques, mais aussi une conscience des rapports de force et des réalités institutionnelles belges.
Enfin, ma formation universitaire m’a transmis un certain sens de la déontologie : le respect des procédures, l’importance du débat contradictoire, la vigilance face aux abus de pouvoir. C’est un socle éthique qui, dans le monde politique, où la tentation du raccourci ou de la communication facile est forte, me sert de boussole. On peut dire, sans exagération, qu’elle est un garde-fou aussi bien qu’un levier d’action.
Quel rôle sociétal joue ou devrait selon vous jouer la science politique dans la Belgique contemporaine ?
En Belgique, pays institutionnellement complexe et culturellement diversifié, la science politique a un rôle crucial à jouer. Elle doit être un outil de clarification pour les citoyennes et citoyens, souvent déroutés par les arcanes du système fédéral, les compétences partagées, les réformes institutionnelles successives. Elle peut ainsi contribuer à la pédagogie démocratique, en expliquant les règles du jeu, les évolutions historiques et les enjeux contemporains.
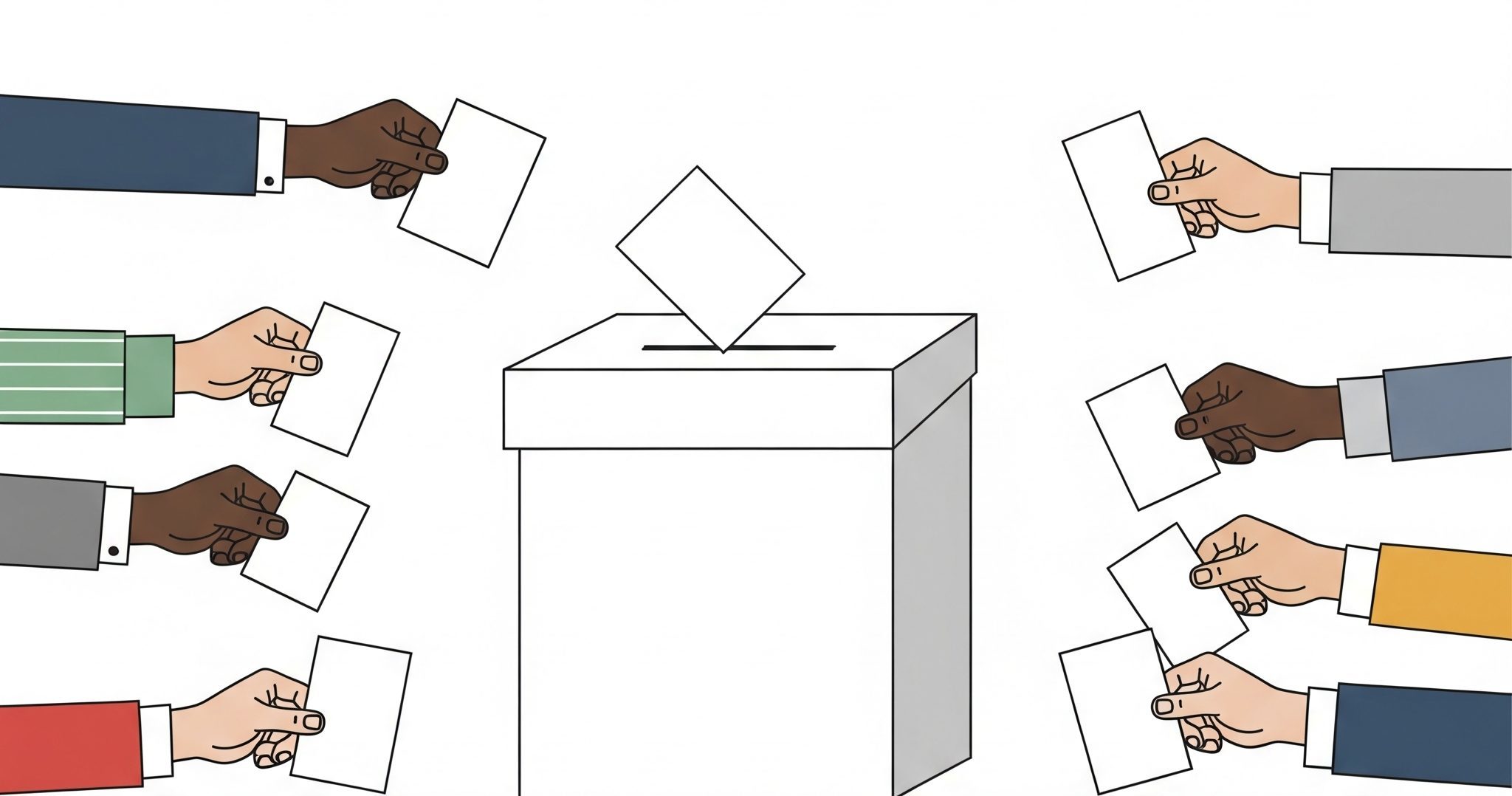
Mais la science politique doit aussi être un contre-pouvoir. Dans un contexte où les institutions sont parfois remises en cause (encore récemment M. De Wever qui s'en prend aux magistrats), où les réseaux sociaux favorisent la désinformation, où les extrêmes gagnent du terrain, elle doit rappeler les fondements de notre démocratie : l’État de droit, la séparation des pouvoirs, la représentativité, la participation citoyenne. En ce sens, elle joue un rôle de veille critique, presque de "conscience civique".
Elle a également une fonction prospective. Elle peut nourrir la réflexion sur des enjeux fondamentaux comme la réforme de l’État (est-ce vraiment bien rationnel et efficace d'éclater toujours plus les compétences entre niveaux de pouvoirs ?), la participation délibérative, le rapport entre représentativité et gouvernance, l’impact des nouvelles technologies sur le politique ou encore l'immixtion de la religion dans des décisions politiques. À condition que les chercheurs soient écoutés, que leurs travaux soient valorisés dans le débat public, la science politique peut devenir un levier de modernisation de notre démocratie.
La science politique a-t-elle contribué aux développements et aux évolutions de DéFI ces dernières années ?
Oui, incontestablement. Même si ce n’est pas toujours visible ou revendiqué publiquement, la réflexion issue de la science politique a influencé plusieurs des orientations prises par DéFI au fil du temps. Il ne s’agit pas simplement d’une inspiration théorique, mais bien d’une volonté d’ancrer nos choix dans une compréhension approfondie des dynamiques politiques, sociales et institutionnelles.
La manière dont DéFI a analysé les questions liées à la gouvernance, à la transparence, à l’efficacité des institutions, à la représentation démocratique, à la place des femmes en politique et aux difficultés qu'elles rencontrent notamment en campagne électorale (en particulier le sexisme), est fortement nourrie par les travaux et les débats issus de la science politique.

La réflexion sur les partis eux-mêmes – leur organisation interne, leur rôle dans la démocratie représentative, leur capacité à se renouveler – fait également partie des domaines où la science politique éclaire notre action. Chez DéFI, cela nous a amenés à revoir certains aspects de notre fonctionnement interne, à favoriser la participation des membres, à mieux articuler l’ancrage local avec les orientations nationales. L’analyse des tendances électorales, des comportements de vote, ou encore des transformations de l’opinion publique, constitue aussi un outil précieux pour ajuster notre stratégie politique sans pour autant renier nos convictions.
Enfin, la culture du débat, du pluralisme et de la délibération est au cœur de notre identité. Elle doit beaucoup à la méthode scientifique, qui privilégie la confrontation des idées, l’argumentation rigoureuse, et le refus des dogmes. En ce sens, la science politique ne se contente pas de nous observer ; elle dialogue avec nous et participe activement à notre évolution.
La science politique aura-t-elle un rôle à jouer dans la réflexion engagée il y a peu sur les trajectoires futures de votre parti ?
Absolument. La science politique peut – et doit – nous aider à penser notre avenir de manière lucide et innovante. La réflexion actuellement engagée au sein de DéFI sur nos trajectoires futures s’inscrit dans un contexte de bouleversements profonds : recomposition du paysage politique belge, montée des extrêmes, défiance croissante envers les partis traditionnels, exigence accrue de participation citoyenne, transformations technologiques et environnementales majeures.
Dans le cadre de notre processus de modernisation suite à notre défaite électorale, la science politique peut être une alliée stratégique pour "oser l'avenir", l'avenir du parti et l'avenir de notre société. Elle peut nous aider à comprendre les attentes nouvelles des électeurs, à anticiper les recompositions idéologiques, à repenser notre modèle de parti. Elle peut aussi nourrir une réflexion sur nos alliances potentielles, notre positionnement institutionnel et notre communication. En analysant les expériences d’autres formations politiques, en Belgique comme à l’étranger, elle nous offre des points de comparaison utiles, sans jamais dicter des recettes toutes faites.
Mais plus profondément, la science politique peut contribuer à notre capacité d’auto-évaluation. Elle peut nous pousser à remettre en question nos routines, à identifier nos angles morts, à interroger la manière dont nous construisons notre légitimité. Dans une démarche d’innovation démocratique, elle peut accompagner notre volonté de bâtir un projet politique à la fois fidèle à nos valeurs – celles du libéralisme social, de l’émancipation individuelle, du respect des minorités et de l'État de droit – et résolument tourné vers l’avenir.
C’est pourquoi nous avons tout intérêt à ouvrir davantage nos portes aux politologues, aux chercheurs, aux universitaires, y compris dans nos instances de réflexion stratégique.
Le monde de la recherche reste un univers particulièrement masculin et peu diversifié, la science politique ne faisant pas exception à ce constat. De quelle manière pourrions-nous aboutir à une féminisation accrue de la recherche ?
La sous-représentation des femmes dans la recherche, y compris en science politique, est une réalité préoccupante, et elle reflète des inégalités systémiques qu’il est urgent de combattre. Il ne s’agit pas uniquement d’un enjeu de parité statistique, mais d’un enjeu de justice, de qualité scientifique et de richesse intellectuelle. Une science politique trop homogène dans ses profils, ses parcours et ses références théoriques se prive de regards essentiels sur le monde social et politique.
La première étape est celle de l’égalité des chances dès le départ. Il faut lutter contre les biais implicites dès l'école, dès l’orientation des jeunes femmes vers les carrières académiques, et assurer un encadrement plus inclusif dans les parcours de doctorat. Cela implique de revoir les critères de recrutement, de mieux valoriser les travaux portant sur les questions de genre, de minorités ou de rapports de pouvoir, encore trop souvent relégués à la marge.

Ensuite, il faut des mesures structurelles. La mise en place de quotas dans certaines instances académiques peut être un levier temporaire, à condition qu’elle s’accompagne d’un soutien réel aux carrières féminines : accès au financement, reconnaissance des publications, équilibres dans les charges d’enseignement et d’administration. Il faut aussi penser à la conciliation entre vie professionnelle et vie privée, encore trop souvent à la charge des femmes.
Mais au-delà des dispositifs, il faut un changement de culture. Cela passe par la valorisation de modèles féminins dans le monde académique, par la formation des équipes dirigeantes à la lutte contre le sexisme ordinaire, et par une volonté politique claire au sein des universités. La science politique, en tant que discipline critique, devrait être à l’avant-garde de ce combat. Elle a les outils pour penser les inégalités : elle doit aussi les combattre en son sein.
Chez DéFI, nous portons cette exigence d’égalité dans tous les secteurs, y compris dans l’enseignement supérieur et la recherche. La féminisation de la science politique comme de tout autre secteur où les femmes sont marginalisées est un enjeu démocratique. Elle conditionne la qualité et la légitimité du regard porté sur notre société.
La Belgique est-elle à l'abri des entraves à la liberté académique et à la recherche, comme cela peut être observé dans d'autres pays ? Quelles mesures peuvent être prises pour garantir et renforcer cette liberté dans le contexte belge ?
La Belgique bénéficie aujourd’hui d’un cadre relativement protecteur en matière de liberté académique. Nos universités jouissent d’une autonomie réelle, les chercheurs peuvent s’exprimer librement, et il n’existe pas, à ce jour, de pression systémique de l’État sur les contenus scientifiques. Toutefois, nous ne devons pas céder à une forme de naïveté : cette liberté n’est jamais définitivement acquise. Elle doit être défendue et consolidée en permanence.
La science politique est une science, et comme toute science, elle peut faire l'objet de menaces qui peuvent être multiples : pressions politiques sur certaines recherches sensibles, dépendance croissante vis-à-vis de financements privés ou orientés, autocensure par peur des controverses médiatiques, ou encore attaques ciblées contre des chercheurs engagés. Il faut aussi être attentif à la polarisation croissante du débat public, qui peut entraîner une disqualification hâtive des expertises dès qu’elles contredisent certaines idéologies.

Pour préserver cette liberté, plusieurs leviers sont à activer. D’abord, garantir un financement public stable, transparent et pluraliste de la recherche, qui permette aux chercheurs de travailler sans pression. Ensuite, renforcer les instances de médiation et de défense de l’intégrité académique. Par ailleurs, il faut une protection juridique efficace pour les universitaires menacés ou attaqués en raison de leurs travaux ou prises de parole.
Mais il y a aussi un enjeu culturel : réaffirmer, dans le débat public, la valeur de l’expertise, la légitimité de la recherche scientifique, le droit au doute, à la critique et à la nuance. Dans un monde saturé d’opinions, il est vital de rappeler que la recherche n’est pas une opinion parmi d’autres, mais un processus exigeant, fondé sur des méthodes et une déontologie.
Chez DéFI, nous sommes résolument attachés à cette liberté démocratique, qui est l’un des piliers de l’État de droit. Elle garantit une société ouverte, capable de se remettre en question. Défendre la liberté académique, c’est défendre la démocratie.
L'entretien a été réalisé le 12 mai 2025
Images : (1) "Bruxelles - Mont des Arts (27-07-1914)" by Laurent Simonis is licensed under CC BY 2.0; (2) Image générée par IA ; (3) "Flashmob contre les violences faites aux femmes - 'Un violador in tu camino', Lastesis" by Gustave Deghilage is licensed under CC BY-NC-ND 2.0 ; (4) Image générée par IA ; (5) Image générée par IA


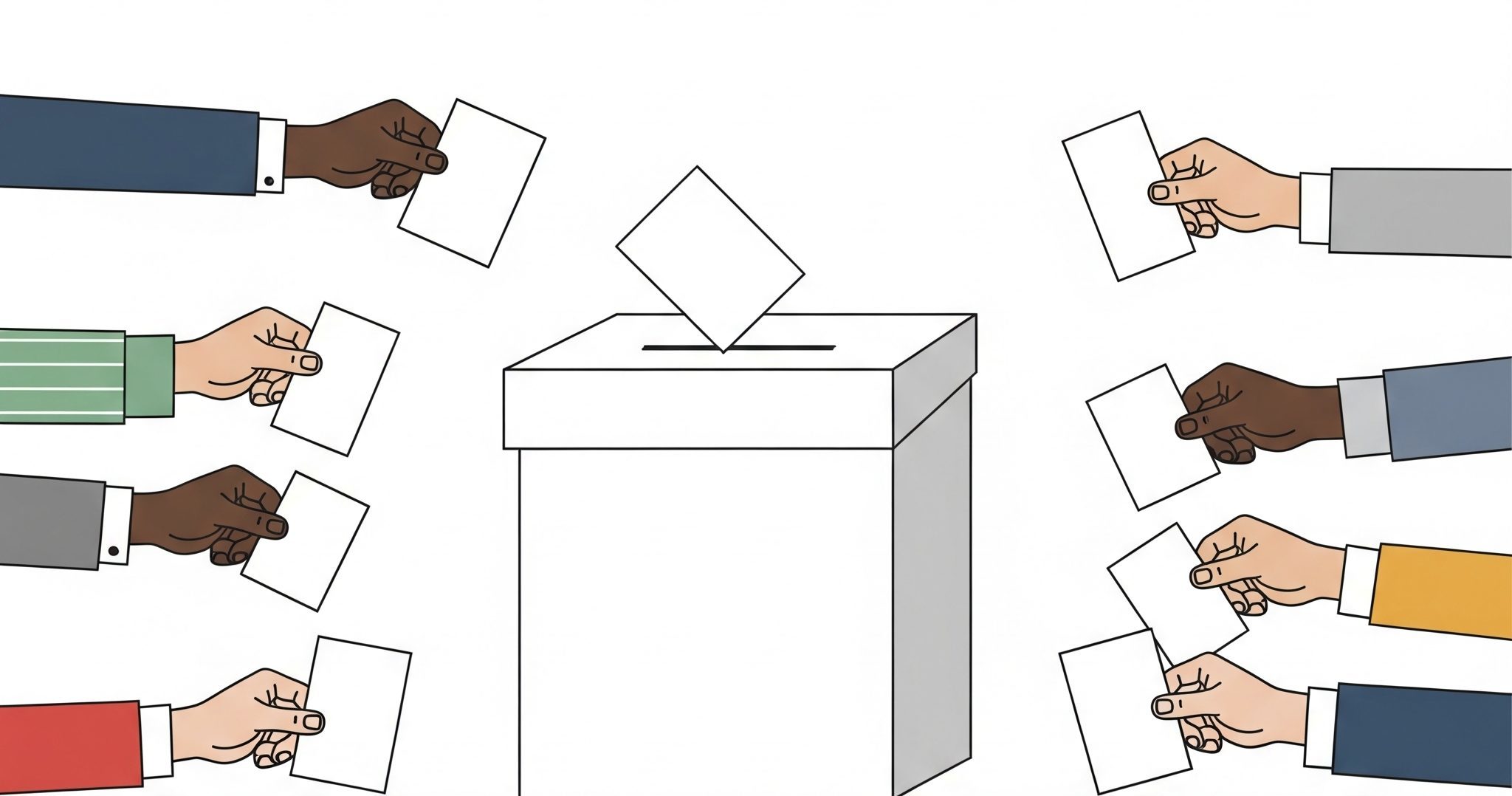 Mais la science politique doit aussi être un contre-pouvoir. Dans un contexte où les institutions sont parfois remises en cause (encore récemment M. De Wever qui s'en prend aux magistrats), où les réseaux sociaux favorisent la désinformation, où les extrêmes gagnent du terrain, elle doit rappeler les fondements de notre démocratie : l’État de droit, la séparation des pouvoirs, la représentativité, la participation citoyenne. En ce sens, elle joue un rôle de veille critique, presque de "conscience civique".
Elle a également une fonction prospective. Elle peut nourrir la réflexion sur des enjeux fondamentaux comme la réforme de l’État (est-ce vraiment bien rationnel et efficace d'éclater toujours plus les compétences entre niveaux de pouvoirs ?), la participation délibérative, le rapport entre représentativité et gouvernance, l’impact des nouvelles technologies sur le politique ou encore l'immixtion de la religion dans des décisions politiques. À condition que les chercheurs soient écoutés, que leurs travaux soient valorisés dans le débat public, la science politique peut devenir un levier de modernisation de notre démocratie.
Mais la science politique doit aussi être un contre-pouvoir. Dans un contexte où les institutions sont parfois remises en cause (encore récemment M. De Wever qui s'en prend aux magistrats), où les réseaux sociaux favorisent la désinformation, où les extrêmes gagnent du terrain, elle doit rappeler les fondements de notre démocratie : l’État de droit, la séparation des pouvoirs, la représentativité, la participation citoyenne. En ce sens, elle joue un rôle de veille critique, presque de "conscience civique".
Elle a également une fonction prospective. Elle peut nourrir la réflexion sur des enjeux fondamentaux comme la réforme de l’État (est-ce vraiment bien rationnel et efficace d'éclater toujours plus les compétences entre niveaux de pouvoirs ?), la participation délibérative, le rapport entre représentativité et gouvernance, l’impact des nouvelles technologies sur le politique ou encore l'immixtion de la religion dans des décisions politiques. À condition que les chercheurs soient écoutés, que leurs travaux soient valorisés dans le débat public, la science politique peut devenir un levier de modernisation de notre démocratie.
 La réflexion sur les partis eux-mêmes – leur organisation interne, leur rôle dans la démocratie représentative, leur capacité à se renouveler – fait également partie des domaines où la science politique éclaire notre action. Chez DéFI, cela nous a amenés à revoir certains aspects de notre fonctionnement interne, à favoriser la participation des membres, à mieux articuler l’ancrage local avec les orientations nationales. L’analyse des tendances électorales, des comportements de vote, ou encore des transformations de l’opinion publique, constitue aussi un outil précieux pour ajuster notre stratégie politique sans pour autant renier nos convictions.
Enfin, la culture du débat, du pluralisme et de la délibération est au cœur de notre identité. Elle doit beaucoup à la méthode scientifique, qui privilégie la confrontation des idées, l’argumentation rigoureuse, et le refus des dogmes. En ce sens, la science politique ne se contente pas de nous observer ; elle dialogue avec nous et participe activement à notre évolution.
La réflexion sur les partis eux-mêmes – leur organisation interne, leur rôle dans la démocratie représentative, leur capacité à se renouveler – fait également partie des domaines où la science politique éclaire notre action. Chez DéFI, cela nous a amenés à revoir certains aspects de notre fonctionnement interne, à favoriser la participation des membres, à mieux articuler l’ancrage local avec les orientations nationales. L’analyse des tendances électorales, des comportements de vote, ou encore des transformations de l’opinion publique, constitue aussi un outil précieux pour ajuster notre stratégie politique sans pour autant renier nos convictions.
Enfin, la culture du débat, du pluralisme et de la délibération est au cœur de notre identité. Elle doit beaucoup à la méthode scientifique, qui privilégie la confrontation des idées, l’argumentation rigoureuse, et le refus des dogmes. En ce sens, la science politique ne se contente pas de nous observer ; elle dialogue avec nous et participe activement à notre évolution.
 Ensuite, il faut des mesures structurelles. La mise en place de quotas dans certaines instances académiques peut être un levier temporaire, à condition qu’elle s’accompagne d’un soutien réel aux carrières féminines : accès au financement, reconnaissance des publications, équilibres dans les charges d’enseignement et d’administration. Il faut aussi penser à la conciliation entre vie professionnelle et vie privée, encore trop souvent à la charge des femmes.
Mais au-delà des dispositifs, il faut un changement de culture. Cela passe par la valorisation de modèles féminins dans le monde académique, par la formation des équipes dirigeantes à la lutte contre le sexisme ordinaire, et par une volonté politique claire au sein des universités. La science politique, en tant que discipline critique, devrait être à l’avant-garde de ce combat. Elle a les outils pour penser les inégalités : elle doit aussi les combattre en son sein.
Chez DéFI, nous portons cette exigence d’égalité dans tous les secteurs, y compris dans l’enseignement supérieur et la recherche. La féminisation de la science politique comme de tout autre secteur où les femmes sont marginalisées est un enjeu démocratique. Elle conditionne la qualité et la légitimité du regard porté sur notre société.
Ensuite, il faut des mesures structurelles. La mise en place de quotas dans certaines instances académiques peut être un levier temporaire, à condition qu’elle s’accompagne d’un soutien réel aux carrières féminines : accès au financement, reconnaissance des publications, équilibres dans les charges d’enseignement et d’administration. Il faut aussi penser à la conciliation entre vie professionnelle et vie privée, encore trop souvent à la charge des femmes.
Mais au-delà des dispositifs, il faut un changement de culture. Cela passe par la valorisation de modèles féminins dans le monde académique, par la formation des équipes dirigeantes à la lutte contre le sexisme ordinaire, et par une volonté politique claire au sein des universités. La science politique, en tant que discipline critique, devrait être à l’avant-garde de ce combat. Elle a les outils pour penser les inégalités : elle doit aussi les combattre en son sein.
Chez DéFI, nous portons cette exigence d’égalité dans tous les secteurs, y compris dans l’enseignement supérieur et la recherche. La féminisation de la science politique comme de tout autre secteur où les femmes sont marginalisées est un enjeu démocratique. Elle conditionne la qualité et la légitimité du regard porté sur notre société.
 Pour préserver cette liberté, plusieurs leviers sont à activer. D’abord, garantir un financement public stable, transparent et pluraliste de la recherche, qui permette aux chercheurs de travailler sans pression. Ensuite, renforcer les instances de médiation et de défense de l’intégrité académique. Par ailleurs, il faut une protection juridique efficace pour les universitaires menacés ou attaqués en raison de leurs travaux ou prises de parole.
Mais il y a aussi un enjeu culturel : réaffirmer, dans le débat public, la valeur de l’expertise, la légitimité de la recherche scientifique, le droit au doute, à la critique et à la nuance. Dans un monde saturé d’opinions, il est vital de rappeler que la recherche n’est pas une opinion parmi d’autres, mais un processus exigeant, fondé sur des méthodes et une déontologie.
Chez DéFI, nous sommes résolument attachés à cette liberté démocratique, qui est l’un des piliers de l’État de droit. Elle garantit une société ouverte, capable de se remettre en question. Défendre la liberté académique, c’est défendre la démocratie.
L'entretien a été réalisé le 12 mai 2025
Images : (1) "Bruxelles - Mont des Arts (27-07-1914)" by Laurent Simonis is licensed under CC BY 2.0; (2) Image générée par IA ; (3) "Flashmob contre les violences faites aux femmes - 'Un violador in tu camino', Lastesis" by Gustave Deghilage is licensed under CC BY-NC-ND 2.0 ; (4) Image générée par IA ; (5) Image générée par IA
Pour préserver cette liberté, plusieurs leviers sont à activer. D’abord, garantir un financement public stable, transparent et pluraliste de la recherche, qui permette aux chercheurs de travailler sans pression. Ensuite, renforcer les instances de médiation et de défense de l’intégrité académique. Par ailleurs, il faut une protection juridique efficace pour les universitaires menacés ou attaqués en raison de leurs travaux ou prises de parole.
Mais il y a aussi un enjeu culturel : réaffirmer, dans le débat public, la valeur de l’expertise, la légitimité de la recherche scientifique, le droit au doute, à la critique et à la nuance. Dans un monde saturé d’opinions, il est vital de rappeler que la recherche n’est pas une opinion parmi d’autres, mais un processus exigeant, fondé sur des méthodes et une déontologie.
Chez DéFI, nous sommes résolument attachés à cette liberté démocratique, qui est l’un des piliers de l’État de droit. Elle garantit une société ouverte, capable de se remettre en question. Défendre la liberté académique, c’est défendre la démocratie.
L'entretien a été réalisé le 12 mai 2025
Images : (1) "Bruxelles - Mont des Arts (27-07-1914)" by Laurent Simonis is licensed under CC BY 2.0; (2) Image générée par IA ; (3) "Flashmob contre les violences faites aux femmes - 'Un violador in tu camino', Lastesis" by Gustave Deghilage is licensed under CC BY-NC-ND 2.0 ; (4) Image générée par IA ; (5) Image générée par IA